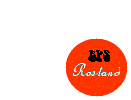I Présentation, orientation, dominante:
![]() C’est
une priorité de l’enseignement des APS au collège, en tant que savoir fondamental
au même titre que lire, écrire et compter.
C’est
une priorité de l’enseignement des APS au collège, en tant que savoir fondamental
au même titre que lire, écrire et compter.
![]() C’est
l’engagement de développer chez l’élève un savoir sécuritaire qui concourt à le
rendre conscient de son engagement dans un milieu à risque comme plus tard dans
les loisirs de pleines natures.
C’est
l’engagement de développer chez l’élève un savoir sécuritaire qui concourt à le
rendre conscient de son engagement dans un milieu à risque comme plus tard dans
les loisirs de pleines natures.
![]() C’est
l’accession au monde de l’eau, source d’un grand plaisir.
C’est
l’accession au monde de l’eau, source d’un grand plaisir.
![]() C’est
enfin l’acquisition d’une habitude au regard de la propreté à avoir avant.
pendant et après le bain, mais aussi de l’hygiène en général.
C’est
enfin l’acquisition d’une habitude au regard de la propreté à avoir avant.
pendant et après le bain, mais aussi de l’hygiène en général.
Quand une
aisance suffisante dans le volume est acquise, un second niveau de pratique
peut prendre en compte les besoins et les goûts des élèves au travers
d’activités plus représentatives comme la recherche en immersion d’objet en
relation avec la notion de sauvetage, l’envie de nager plus vite que les autres
(défis), de nager plus loin (brevet de distance) ou plus longtemps (record de
l’heure).
COMMENT ENTRER DANS L’ACTIVITE
Sans exclure
l’utilisation de la petite profondeur, l’entrée par des évolutions subaquatiques
autonomes en grande profondeur peut-être préférée dans le cas d’un premier
cycle. Elle permet de confronter les élèves aux contraintes d’une immersion
totale d’une durée limitée sans appuis plantaires.
L’élève est
amené à:
![]() repérer
le volume d ‘évolution limité par le fond du bassin,
repérer
le volume d ‘évolution limité par le fond du bassin,
![]() ressentir
la difficulté à se maintenir sous la surface de l’eau à cause d’une poussée
permanente vers le haut,
ressentir
la difficulté à se maintenir sous la surface de l’eau à cause d’une poussée
permanente vers le haut,
![]() essayer
de s’éloigner du bord tout en anticipant le retour afin de maîtriser son degré
d’engagement, sous l’eau, nécessitant un placement particulier des segments,
essayer
de s’éloigner du bord tout en anticipant le retour afin de maîtriser son degré
d’engagement, sous l’eau, nécessitant un placement particulier des segments,
![]() se
déplacer ou faire du sur place en utilisant des appuis variés,
se
déplacer ou faire du sur place en utilisant des appuis variés,
Il Contexte
et conditions d’apprentissage:
La mise en place
d’un cycle de travail réalisé le plus souvent en grande profondeur implique une
vigilance de tous les instants avec ces élèves non nageurs souvent inconscients
de leur niveau de compétence. Des précautions sont à prendre et relatée dans le
texte relatif aux activités aquatiques des documents d’accompagnement des programmes.
L ‘observation de son propre corps peut
mettre mal à l‘aise l‘élève en déficit d ‘image et entraîner une
dispense ou un oubli de tenue. Une mise à
l’eau rapide lors de / ‘arrivée
sur le bord du bassin raccourcit ce moment qui peut gêner certains. Par
exemple, le travail du plongeon ou des sauts à la première séance est à éviter
en début de cycle.
DUREE
Pour
l’acquisition d’une autonomie complète sous l’eau, à la surface et à l’entrée
dans l’eau, un cycle de 12 séances de 50 minutes
effectives nous paraît nécessaire.
L’acquisition de
ces premières autonomies sera plus longue si l’élève présente une peur de l’eau
importante et non résolue lors de ce premier cycle. Ces lacunes, relevant d’une
phase de familiarisation, imposeront peut-être la mise en place d’un deuxième
cycle «de soutien » pour obtenir les premières autonomies.
L ‘accès à la profondeur, là où l ‘élève n
‘a pas pied, est à privilégier le plus tôt et
le plus souvent possible pour accélérer le passage du statut de non nageur
à celui de nageur.
III Mise en oeuvre:
1. Compétences:
Compétences
propres au groupement
![]() maîtriser
la capacité à maintenir un équilibre propice au déplacement. établir et rompre l’équilibre
horizontal, orienter et mobiliser la tête en conséquence, utiliser des repères
visuels, aligner et allonger le corps et les segments,
maîtriser
la capacité à maintenir un équilibre propice au déplacement. établir et rompre l’équilibre
horizontal, orienter et mobiliser la tête en conséquence, utiliser des repères
visuels, aligner et allonger le corps et les segments,
![]() maîtriser
la respiration, utiliser diverses solutions pour s immerger en variant les
formes et le débit de la respiration,
maîtriser
la respiration, utiliser diverses solutions pour s immerger en variant les
formes et le débit de la respiration,
![]() maîtriser
la propulsion par l’orientation des surfaces propulsives, le rythme et la
continuité des actions.
maîtriser
la propulsion par l’orientation des surfaces propulsives, le rythme et la
continuité des actions.
Compétence
spécifique proposée
Enchaîner lors
d’un même parcours une entrée dans l’eau, des déplacements différents, des positions
inhabituelles, des arrêts, des immersions et des recherches d’objets
immergés....
La réussite au 50m est devenu caduque avec
i ‘ouverture sur les loisirs nautiques de pleine nature.
Nous nous
devons de proposer à nos élèves une autonomie plus large que celle de
surface pour ouvrir son potentiel d’action en toute sécurité.
La notion d’enchaînement recoupe cette nécessité en y apportant un
versant énergétique. En effet, qui peut dire la variété d’action motrices et la
durée de ce/le-ci mises enjeu quand
il s ‘agit de se sortir du « pétrin », car il n ‘y a pas de « pouce mouillé »
pour arrêter l ‘action...
Etapes vers la réalisation de cette
compétence:
![]() Si je descend au fond, je dois être capable
de remonter en me tirant le long d’une perche puis en me repoussant du fond
voir en me laissant remonter passivement sans mouvement.
Si je descend au fond, je dois être capable
de remonter en me tirant le long d’une perche puis en me repoussant du fond
voir en me laissant remonter passivement sans mouvement.
![]() Si
je veux m’éloigner plus du bord, je dois pouvoir y revenir.
Si
je veux m’éloigner plus du bord, je dois pouvoir y revenir.
![]() Si
je suis fatigué, je dois savoir me mettre sur le dos.
Si
je suis fatigué, je dois savoir me mettre sur le dos.
Compétences
générales EPS
![]() Estimer
son degré d’engagement avec justesse,
Estimer
son degré d’engagement avec justesse,
![]() Exercer
la surveillance de son partenaire,
Exercer
la surveillance de son partenaire,
![]() Observer
des critères de réussites et
Observer
des critères de réussites et
d’efficacité pour les évaluer.
Education concrète à la citoyenneté
Un exemple de
situation permettant l’acquisition de la prudence par les élèves: le travail en
binôme, un nageur dans l’eau est un « guetteur» en dehors de l’eau, peut
contribuer à développer l’esprit de solidarité et d’entraide. Le guetteur a
pour fonction d’observer le nageur et de détecter les moments où il se trouve
en difficulté (discerner une motricité normale d’une motricité anarchique
consécutive à la mise en difficulté, si ce n’est en danger du nageur). A la
notion de sécurité active, «j’apprends à nager », s’ajoute la notion de
sécurité passive, «j’apprends à reconnaître les moments de difficulté d’un
nageur pour lui prêter assistance dans la mesure de mes moyens ».
Pour soi-même,
la préservation de son intégrité physique implique la conscience de ses
possibilités. Donc si je m’éloigne, je dois pouvoir revenir en toute sécurité.
La
responsabilité de mes actions m’engage en premier lieu mais aussi ceux qui vont
avoir à me secourir et m’implique dans une réflexion sur la responsabilité de
ses actes.
2. Contenus
d’enseignement:
Relation directe à l’action:
![]() Admettre
la flottaison naturelle du corps et utiliser le volume pulmonaire pour la faire
varier,
Admettre
la flottaison naturelle du corps et utiliser le volume pulmonaire pour la faire
varier,
![]() Comprendre
le rôle de la tête dans l’équilibre et l’orientation du corps.
Comprendre
le rôle de la tête dans l’équilibre et l’orientation du corps.
![]() Construire
un « profil » du corps pour diminuer les résistances du corps au déplacement,
Construire
un « profil » du corps pour diminuer les résistances du corps au déplacement,
![]() Utiliser
différentes orientations et vitesses des segments pour « s’appuyer» sur l’eau.
Utiliser
différentes orientations et vitesses des segments pour « s’appuyer» sur l’eau.
Permettant l’action:
![]() Observer
des critères de réussites et d’efficacité de la nage pour les évaluer.
Observer
des critères de réussites et d’efficacité de la nage pour les évaluer.
![]() Exercer
une surveillance sur son partenaire.
Exercer
une surveillance sur son partenaire.
Trame prévisionnelle:
A: EXPLORANT la profondeur: montrer qu’il existe
un fond
B : PRENANT des repères visuels dans l’eau: faire
ouvrir les yeux
C : ACCEPTANT la poussée d’Archimède : faire sentir
qu’il est plus difficile de rester au fond que de remonter
D : MAITRISANT l’apnée : faire comprendre que l’on
peut bloquer sa respiration sans « mourir »
E: DIMINUANT les résistances à l’entrée dans
l’eau: montrer qu’il faut entrer dans l’eau par la plus petite surface
F: ETABLISSANT le rôle de la tête dans les changements
d’équilibre: faire sentir que la tête de gouvernail
G: CONSTRUISANT le déplacement par l’orientation
des surfaces motrices: faire utiliser la loi d’action réaction
Dl: Apnée de 10, 20, 30 sec à sec
D2 : Apnée dans l’eau
Bi : Faire prendre des signaux dans l’eau
Ai : Descendre toucher le fond à différentes
profondeurs
A2 : Remonter avec ou sans appui
Fl: S’allonger avec ou sans appui
G1 : Déplacement le long du mur avec ou sans
appui
F2: Sentir le couple de redressement
D3
: Différencier l’apnée en inspiration et
en expiration
D4
: Souffler pour vider les poumons
Cl
: Etre sur le ventre ou sur le dos avec
ou sans appui
A3
: Remontée active
F3
: Glissée ventrale ou dorsale
C2
: Remontée passive
F4
: Coulée ventrale
E1
: Sauter de différentes hauteurs
G2 Coulée +
Battements(ventral) Glissée + Battements
(dorsal)
G3
: Se déplacer en apnée avec ou sans appui
E2
: Sauter pour rester à la surface ou au
fond
G4 : Déplacement
sur le ventre ou sur le dos avec ou sans appui
F5
: Passer de la position ventrale à la
position dorsale et inversement
G5
: Faire du sur place, enchaîner deux
tâches Enchaîner toutes les tâches
REMARQUES :11 est possible d’apporter une certaine
souplesse dans la chronologie de cette liste. Pour augmenter la difficulté, il
est possible de faire varier la profondeur, la hauteur des sauts, le temps
d’apnée, le poids de l’objet, la distance entre les perches, la distance nagée.
la vitesse d’exécution de l’enchaînement.
3. Réutilisation
des savoirs acquis:
![]() EPS
: observer des critères de réussites et d’efficacité sur le corps,
EPS
: observer des critères de réussites et d’efficacité sur le corps,
![]() COURSE
DE DUREE : utiliser
l’expiration active
COURSE
DE DUREE : utiliser
l’expiration active
![]() GYMNASTIQUE: se renverser la tête en bas, rôle de la
tête dans l’orientation du corps,
GYMNASTIQUE: se renverser la tête en bas, rôle de la
tête dans l’orientation du corps,
![]() MUSIQUE
: utiliser l’expiration
active,
MUSIQUE
: utiliser l’expiration
active,
![]() MATHEMATIQUES
: notion de volume,
MATHEMATIQUES
: notion de volume,
![]() SCIENCES-PHYSIQUES : poussée d’Archimède, centre de gravité.
centre des volumes,
SCIENCES-PHYSIQUES : poussée d’Archimède, centre de gravité.
centre des volumes,
![]() EDUCATION
CIVIQUE : respect de
règles pour tous, se protéger du risque mais aussi protéger les autres,
responsabilité de l’autre.
EDUCATION
CIVIQUE : respect de
règles pour tous, se protéger du risque mais aussi protéger les autres,
responsabilité de l’autre.
DE
QUELLE MANIERE
Forme
de pratique retenue
Réaliser des parcours
au-dessus, à la surface et en dessous de l’eau de complexité de plus en plus
importante au regard des compétences à mettre en oeuvre, de la profondeur et de
distance à parcourir.
COMMENT
EVALUER LES TRANSFORMATIONS?
L’enseignant veille à proposer
une concrétisation de l’évaluation sous la forme de:
![]() L’obtention
de «diplômes» représentants la réussite au parcours de niveaux de difficultés
différents.
L’obtention
de «diplômes» représentants la réussite au parcours de niveaux de difficultés
différents.
![]() Le
passage de brevets, de distances, car il certifie le degré du savoir nager qui
permet l’accès aux activités physiques de pleines natures (S0mètres). Mais
surtout, il matérialise durablement la réussite pour lui-même et pour son
entourage à une épreuve représentative du savoir nager.
Le
passage de brevets, de distances, car il certifie le degré du savoir nager qui
permet l’accès aux activités physiques de pleines natures (S0mètres). Mais
surtout, il matérialise durablement la réussite pour lui-même et pour son
entourage à une épreuve représentative du savoir nager.
Choix des observables
![]() Maîtrise
l’eau dans sa bouche sans tousser,
Maîtrise
l’eau dans sa bouche sans tousser,
![]() L’immersion
aussi longue soit elle n’entraîne pas un retour à la surface «explosif et
paniqué »,
L’immersion
aussi longue soit elle n’entraîne pas un retour à la surface «explosif et
paniqué »,
![]() Saute
dans l’eau quelle que soit la profondeur voir se positionne pour aller plus profond,
Saute
dans l’eau quelle que soit la profondeur voir se positionne pour aller plus profond,
![]() Economise
ses mouvements pour descendre en utilisant le poids des jambes ou en restant
placé dans la coulée,
Economise
ses mouvements pour descendre en utilisant le poids des jambes ou en restant
placé dans la coulée,
![]() Ne
se bouche plus le nez mais utilise les mains pour nager,
Ne
se bouche plus le nez mais utilise les mains pour nager,
![]() Enchaîne
le parcours sans arrêts,
Enchaîne
le parcours sans arrêts,
![]() Choisit
la distance à l’aller qui lui permette le retour en toute sécurité au dessus
comme en dessous de l’eau,
Choisit
la distance à l’aller qui lui permette le retour en toute sécurité au dessus
comme en dessous de l’eau,
![]() Reste
calme devant l’inconnu surtout dans l’eau où le relâchement est important.
Reste
calme devant l’inconnu surtout dans l’eau où le relâchement est important.